COP 30 au Brésil à Belém/6 au 21 novembre 2025
Les nations du monde entier se retrouvent du 6 au 21 novembre à Belém, au Brésil, pour la 30e Conférence des Parties (COP30). Retrouvez l’essentiel des informations sur cet événement international consacré à la lutte contre le changement climatique.
Qu’est-ce que la COP30 ?
La 30e session de la Conférence des parties (COP) s’inscrit dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC). Ce texte a été adopté à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, afin de lutter contre le changement climatique au niveau mondial. Il s’applique depuis 1994.
Lors des COP, les pays négocient des accords internationaux et veillent au respect des engagements pris par les États en matière de climat. Elles permettent d’évaluer les mesures mises en place et les progrès accomplis par les parties.
Quand et où se déroule la COP30 ?
La COP30 se tient du 6 au 21 novembre à Belém, au Brésil. La première COP s’est déroulée en 1995 à Berlin, en Allemagne. L’année dernière, la COP29 s’est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan.
Qui participe à la COP30 ?
197 pays sont signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC). L’Union européenne est également partie à cette convention, en son nom propre, en plus des 27 États membres qui la composent. Comme chaque année, de nombreux chefs d’État et de gouvernement de ces différents pays doivent faire le déplacement jusqu’au Brésil. Les dirigeants sont attendus les 6 et 7 novembre pour le sommet de haut-niveau. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer seront présents, selon les informations communiquées par ces pays à l’AFP.
Peu d’autres dirigeants – parmi eux ceux de la Colombie ou de l’Afrique du Sud – ont en revanche confirmé leur présence à ce jour, nombre d’entre eux hésitant encore dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et économiques. Côté européen, le président autrichien et le Premier ministre belge ont déjà renoncé à se rendre sur place. Mais c’est surtout l’absence annoncée des États-Unis de Donald Trump, déjà absents de la Conférence des Nations unies sur l’océan, tenue à Nice en juin dernier, qui retient l’attention.
La flambée des prix autour du site de la COP compromet la venue de nombreuses ONG et délégations de pays modestes, menaçant de reléguer les enjeux de fond au second plan. Plusieurs États, dont la Gambie, le Cap-Vert ou encore le Japon, ont déjà annoncé qu’ils réduiraient probablement la taille de leurs délégations. Malgré ces difficultés, le Brésil a résisté aux appels à déplacer l’événement et a prévu d’affréter des bateaux de croisière pour pallier le manque de logements.
Les institutions européennes seront, elles, bien présentes à Bakou. Des délégations de la Commission, du Parlement et du Conseil sont attendues. Le commissaire au climat, à la neutralité carbone et à la croissance propre, Wopke Hoekstra, dirigera à nouveau l’équipe de négociation de l’UE lors de la COP30, en étroite collaboration avec la présidence danoise du Conseil et les États membres afin de s’acquitter du mandat de négociation approuvé le 21 octobre.
La cheffe de l’exécutif européen Ursula von der Leyen, absente l’an dernier, doit elle aussi faire le déplacement cette année. « À la COP30 de cette semaine, nous soulignerons notre ferme attachement à l’Accord de Paris. La transition mondiale vers une économie propre est en cours et irréversible. Notre priorité est de veiller à ce que cette transition soit juste, inclusive et équitable« , a déclaré le 5 novembre l’Allemande.
Des délégations d’organes et d’agences de l’UE participent aussi généralement à l’événement, ainsi que le Comité européen des régions, le Comité économique et social européen (CESE), ou la Banque européenne d’investissement (BEI). La société civile est également conviée aux COP : associations, syndicats, élus locaux, ONG ou encore entreprises et scientifiques sont rassemblés à l’occasion de journées thématiques (énergie, alimentation, tourisme…).
Quels sont les enjeux de la COP30 ?
Alors même que la crise climatique s’aggrave – l’année 2024 ayant été confirmée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant pour la première fois le seuil de 1,5 degré – la COP30 doit réaffirmer la détermination des parties à travailler ensemble et à faire progresser l’action climatique au niveau mondial.
La 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 9 au 29 septembre 2025, a offert un terrain diplomatique propice à la relance de l’agenda climatique en amont de la COP30. Placée sous le signe d’un multilatéralisme renforcé, cette session a vu les États réaffirmer l’urgence d’agir face au dérèglement climatique, au recul de la biodiversité et à la montée des tensions géopolitiques.
Près d’une centaine de pays ont saisi cette tribune pour annoncer ou mettre à jour leurs engagements climatiques en vue du sommet de Belém. Le Brésil, pays hôte de la COP30, a appelé à faire de cette rencontre une « COP de la vérité », tandis que la Chine a présenté sa première cible absolue de réduction d’émissions. De son côté, la France a réaffirmé son appui à la transition énergétique mondiale et à la préservation des écosystèmes.
À l’approche du dixième anniversaire de la signature de l’Accord de Paris, le 12 décembre 2025, la COP30 devra dresser le bilan de l’ambition collective des engagements déterminés au niveau national, préparer leur mise en œuvre à horizon 2035 et corriger tout déficit d’ambition si ces engagements ne sont pas alignés avec les objectifs de l’Accord.
Les Contributions déterminées au niveau national (CDN) sont des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre élaborés par chaque pays dans le cadre de l’Accord de Paris. Ces contributions doivent être mises à jour tous les cinq ans, avec une ambition croissante. Il y a déjà eu deux séries de CDN, en 2015 puis en 2020-2021.
Contrairement aux deux dernières conférences, marquées par des avancées majeures sur les énergies fossiles et la finance, il ne faudra en revanche pas s’attendre cette fois à des annonces fortes ou à de nouveaux accords « sur de gros sujets« , estime Marta Torres-Gunfaus, chercheuse au sein du groupe de réflexion Iddri.
Lors de la précédente conférence en Azerbaïdjan, les pays développés s’étaient engagés à mobiliser au moins 300 milliards de dollars par an d’ici à 2035 pour soutenir les nations les plus vulnérables, afin de les aider à s’adapter aux effets du changement climatique et à amorcer leur transition énergétique.
Cet accord avait cependant été jugé insuffisant dès son adoption, les pays bénéficiaires considérant que les montants devraient être au moins quatre fois plus élevés et dénonçant, en outre, le manque de clarté des modalités de mise en œuvre. Un an plus tard, de nombreuses questions demeurent, à commencer par celle de la nature du financement envisagé (public ou privé).
Face à un enthousiasme limité pour de nouveaux engagements ambitieux, les Brésiliens ont choisi de concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre concrète des mesures déjà décidées. La présidence brésilienne souhaite avant tout démontrer que la coopération internationale reste possible, dans un contexte difficile : retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, tensions commerciales croissantes et montée des mouvements climatosceptiques.
Quel défi pour l’Union européenne ?
L’enjeu de la COP30 est important pour l’Union européenne, à un moment charnière. Ce mercredi 5 novembre, les ministres européens de l’environnement ont arraché un compromis sur les objectifs climatiques de l’Union pour 2035 et 2040, au prix d’une série de concessions.
Après près de vingt heures de négociations, les Vingt-Sept ont trouvé un accord pour réduire leurs émissions de CO2 de 66,25 % à 72,5 % d’ici à 2035 (par rapport à 1990). Ils ont aussi décidé d’une baisse de 90 % de leurs émissions nettes d’ici à 2040 (toujours par rapport à 1990), afin d’atteindre la neutralité climatique en 2050, comme ils s’y sont engagés en inscrivant l’Accord de Paris dans leur loi. Si la cible de 2035 n’est juridiquement pas contraignante, celle de 2040, elle, l’est.
Pour éviter tout blocage de la part des pays les plus réticents, les États membres ont notamment porté de 3 à 5 points la part de l’effort de 90 % de réduction des émissions, qui pourra être réalisé à l’extérieur de l’Union. Une évaluation du texte est également prévue tous les deux ans, avec une clause de révision possible à certaines conditions.
Les ministres européens de l’environnement ont, en outre, soutenu le report d’un an, de 2027 à 2028, de l’extension du marché du carbone au transport routier et au chauffage des bâtiments, une revendication régulière de la Hongrie ou de la Pologne, mais un coup dur pour les pays les plus engagés en faveur du climat, notamment les Scandinaves.
Dans le cadre de l’Accord de Paris, 194 pays ont convenu de maintenir l’évolution moyenne de la température mondiale bien en dessous de 2°C et aussi proche que possible de 1,5 °C d’ici la fin du siècle. Pour ce faire, ils ont accepté de soumettre des contributions déterminées au niveau national qui représentent leurs objectifs individuels de réduction des émissions. L’Union européenne, elle aussi concernée à ce titre, « est fermement attachée à l’Accord de Paris, ayant déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 37 % depuis 1990, tout en développant son économie de près de 70 %, ne représentant que 6 % des émissions mondiales« , rappelle l’institution dans un communiqué.
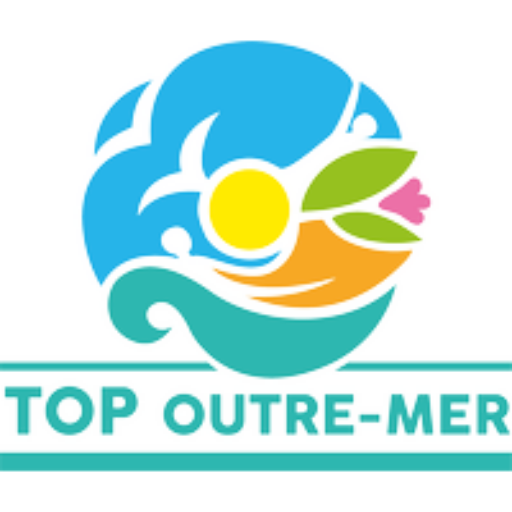
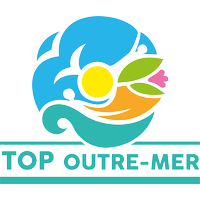







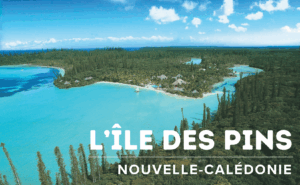





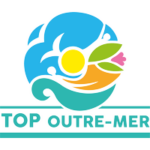
Laisser un commentaire