Colloque international organisé par l’APECE (Association pour l’étudede la colonisation européenne 1750-1850)9-12 avril 2025En partenariat avec l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC, UMR8066, CNRS, ENS, Paris 1), le Centre d’histoire du XIXe siècle.Contre la Révolution française,contre la Révolution haïtienne,les indemnités de 1825
Colloque international organisé par l’APECE (Association pour l’étude
de la colonisation européenne 1750-1850)
9-12 avril 2025
En partenariat avec l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC, UMR
8066, CNRS, ENS, Paris 1), le Centre d’histoire du XIXe siècle.
Contre la Révolution française,
contre la Révolution haïtienne,
les indemnités de 1825
Avec le soutien de la Fondation Esclavage et Réconciliation (FER), la Fondation pour la
mémoire de l’esclavage (FME), la Société des études robespierristes, l’association
PROTEA, le Fonds de dotation Henri Grégoire-Germain Porte, Uppsala Universitet.
Archives nationales diplomatiques
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 17 avril 1825, le roi Charles X signe l’ordonnance reconnaissant l’indépendance d’Haïti,
moyennant le paiement par Haïti d’une indemnité de 150 Millions de Francs-or. Dix jours
plus tard, la loi dite « du milliard aux émigrés », indemnisant ceux qui avaient perdu leurs
biens vendus comme biens nationaux sous la Révolution française, est promulguée par
le roi de France Charles X le 27 avril 1825. L’examen historique conjoint de ces deux
indemnités a rarement fait l’objet d’une analyse comparée.
En 1825, le roi de France Charles X impose aux peuples français et haïtien le paiement de
deux sommes importantes pour indemniser ceux qui ont perdu leurs propriétés en
raison de la Révolution française et de ses répercussions dans la partie française de
Saint-Domingue, devenue indépendante en 1804 sous le nom de Haïti. Le peuple et l’État
d’Haïti devront s’acquitter de 150 millions de francs or en cinq annuités de 30 millions et
le peuple français devra payer trente-trois annuités de 30 millions, soit 990 millions,
presque un milliard, d’où son surnom de « milliard des émigrés ».
La question des indemnités s’inscrit dans celle des secours apportés aux réfugiés de
Saint-Domingue dès la Révolution, comme dans celle des secours et pensions versées
aux anciens émigrés par la liste civile sous la Restauration, dans un contexte de remise
en cause de l’ère des Révolutions. Ces indemnités ont leurs partisans, mais aussi leurs
opposants, y compris parmi les personnes qui ont perdu leurs biens pendant les deux
révolutions. Ainsi, certains colons préfèreraient la reconquête de Saint-Domingue et
récupérer leurs plantations. En France, certains veulent une indemnisation en biens
fonciers plutôt qu’en numéraire. Il y a également des opposants au principe d’indemnité
que l’on trouve notamment dans les rangs des libéraux. Il s’agira d’analyser les débats
et les négociations aboutissant à la mise en place des indemnités.
Selon l’historiographie traditionnelle, l’indemnité d’Haïti a d’abord été proposée par les
présidents haïtiens Pétion et Boyer. Il s’agit d’interroger cette hypothèse. On la considère
comme un moyen de reconnaissance de l’État haïtien, mais aussi comme une garantie
de l’appropriation pour les nouveaux propriétaires de couleur des biens des anciens
colons. D’où vient l’idée de ces indemnités ? Nous savons que les coalisés ont imposé à
la France le paiement de 700 millions de francs-or de réparations après la fin de
l’Empire napoléonien en 1815.
La reconnaissance d’Haïti devient un enjeu diplomatique majeur en Europe et dans les
Amériques, dès le terme de la guerre d’indépendance haïtienne en 1804. L’influence
britannique, les indépendances d’Amérique latine, le point de vue des États-Unis sont à
prendre à compte pour comprendre pourquoi le choix de l’indemnité s’impose en 1825
des deux côtés de l’Atlantique. Plus particulièrement, il faudrait replacer la question de
l’indemnité d’Haïti dans le cadre de l’unification de l’île d’Hispaniola en 1822 et de la fin
du processus des indépendances latino-américaines pour voir comment la question de
l’indemnité s’articule à cette conquête/unification.
Il s’agira aussi d’étudier les modalités effectives des indemnités. L’indemnité d’Haïti est
renégociée et abaissée à 90 millions en 1838. En France, le « milliard des émigrés »
suscite d’importantes tensions politiques. Ces indemnités constituent un précédent pour
la mise en place de l’indemnisation des propriétaires d’esclaves après l’abolition
britannique de l’esclavage en 1833, ou pour l’indemnité de 1849, après la seconde
abolition française de l’esclavage.
Enfin, le « milliard des émigrés » et l’indemnité d’Haïti ont durablement nourri l’imaginaire
des opinions publiques française et haïtienne. Si le « milliard des émigrés aujourd’hui
connu de quelques historiens et érudits, l’indemnité d’Haïti, elle s’inscrit dans le débat sur
le « post-colonialisme » et le « néo-colonialisme ».
En partenariat avec les Archives nationales diplomatiques, l’IHMC (Institut d’histoire
moderne et contemporaine, CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole Normale
Supérieure) et le Centre d’histoire du XIXe siècle (Sorbonne Université, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), l’Association pour l’étude de la colonisation européenne 1750-1850
(APECE) marque le bicentenaire des indemnités décidées en 1825 par l’organisation de
ce colloque international qui permet de relier dans un mêm
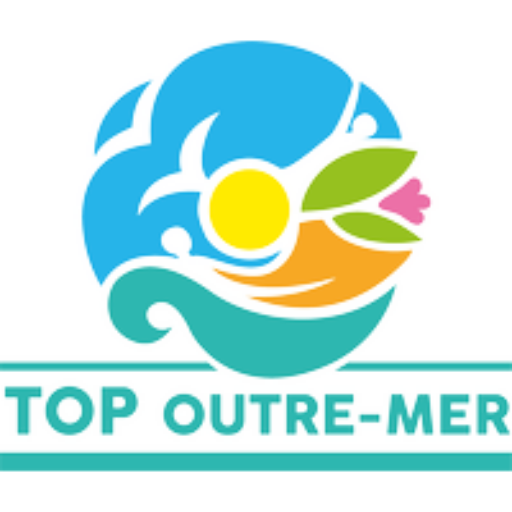
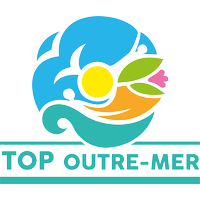
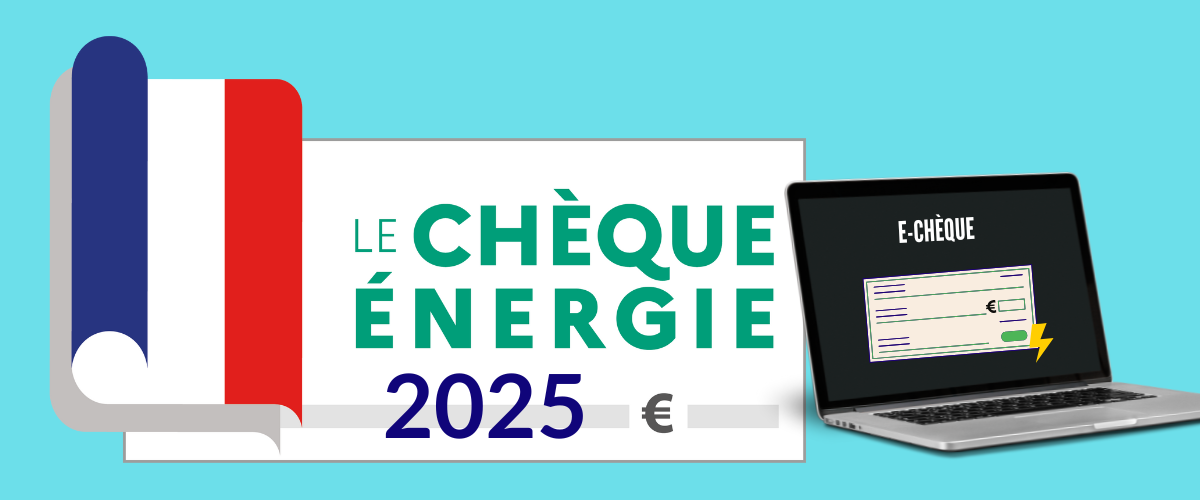






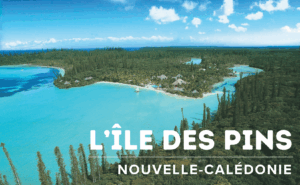





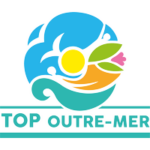
Laisser un commentaire